Portrait de Noé Le Becq, doctorant : planète à la loupe, étude la répartition des glaces d’eau sur Mars
Publié par Laboratoire de planétologie et géosciences (LPG), le 22 mai 2025 650
Le parcours d’une personne qui étudie les planètes est toujours
fascinant : comment se retrouve-t-on à étudier ces mondes mystérieux ?
Pour
Noé, c’est par le biais de documentaires animaliers qu’il regardait aux
côtés de son frère. Curieux de la démarche scientifique, c’est au lycée
que son intérêt se précisera : il découvrira l’exploration spatiale,
l’astronomie, l’exobiologie et enfin un peu plus tard la planétologie.
Pour atteindre son objectif, il se dirige d’abord vers une licence avec
une majeure de physique et une mineure de géosciences à Sorbonne
Université (Paris), lui permettant d’acquérir un parcours
multidisciplinaire. Après cela, il a pu intégrer un master du même
établissement. Après un M1 de géologie à Sorbonne Université, il
rejoindra en M2 un parcours inter-universitaire entre
Sorbonne Université, l’Observatoire de Paris et l’Université
Paris-Saclay. Cela lui permettra de suivre des cours dans une dizaine
d’établissements et laboratoires de planétologie aux thématiques
diverses, bénéficiant ainsi de leur expertise.
Après une première approche de recherche lors de son stage de L3 au Laboratoire de Météorologie Dynamique, où il explora les données météo de la sonde Insight sur Mars, Noé aura l’occasion de compléter son parcours avec deux autres stages au cours de son master. Le premier, réalisé en M1 à l’institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG) portera sur l’analyse de spectres de masse de chondrites carbonées (météorites) afin de comprendre leurs origines. Ce n’est que lors du second stage, en M2, que Noé confirma son attrait pour la géomorphologie, en étudiant au LPG la rhéologie des mélanges de poudres de glace et de sédiments sous conditions froides. Il put alors comparer ses observations aux morphologies observées sur Cérès, une planète naine de la ceinture principale d’astéroïde, encadré par Susan Conway qui passera quelques mois plus tard de maître de stage à directrice de thèse.
Étude des glaces de la planète rouge
La thématique de sa thèse ? Étudier la répartition et la dynamique de la glace d’eau aux moyennes latitudes sur Mars. Pendant sa première année, Noé s’est principalement concentré sur l’étude d’escarpements glacés (similaire à des falaises exposant de la glace d’eau) observés au-delà de 40° de latitude. Suite à une cartographie détaillée, l’objectif était de mieux comprendre leurs mécanismes de formation ainsi que l’origine et l’histoire de cette glace d’eau. Par ses observations, Noé est en capacité de mieux interpréter le climat de la planète, que l’on croyait sèche, glacée et inerte depuis presque 3 milliards d’années.

Néanmoins, les dépôts de glace exposés dans les affleurements ne datent eux que de deux millions d’années, ce qui est très peu à l’échelle géologique. Ses premiers résultats indiquent que cette glace pourrait s’être formée à la suite de chutes de neige à l’épaisseur variable selon la direction du vent et la topographie. Pour effectuer ses observations, Noé utilise divers outils : il explore notamment la complexité des paysages martiens en s’aidant de photos. Pour cela, il utilise les données de sondes qui gravitent en ce moment autour de Mars (Mars Reconnaissance Orbiter, NASA et Trace Gas Orbiter, ESA) et qu’il peut programmer pour obtenir des images de ses objets d’études. Avec une résolution allant jusqu’à 25 cm par pixel, ces données précieuses permettent de mieux comprendre l’origine des structures observées à la surface de la planète.
De plus, en utilisant des images prises à des angles
d’observation légèrement différents, la scène est créée en 3D. Ces
données, appelées MNT (Modèle Numériques de Terrain) rendent alors possible des mesures d’altitude, de pentes ou de volume des paysages.
De telles analyses permettent ainsi de mieux comprendre l’origine et les processus d’évolution des glaces martiennes, ce qui représente divers intérêts tel que comprendre le climat de Mars.
En effet, l’histoire de la glace d’eau permet de mieux connaître
l’évolution du climat de la planète ; un enjeu important, à la fois pour
l’exobiologie mais aussi pour la compréhension du climat terrestre.
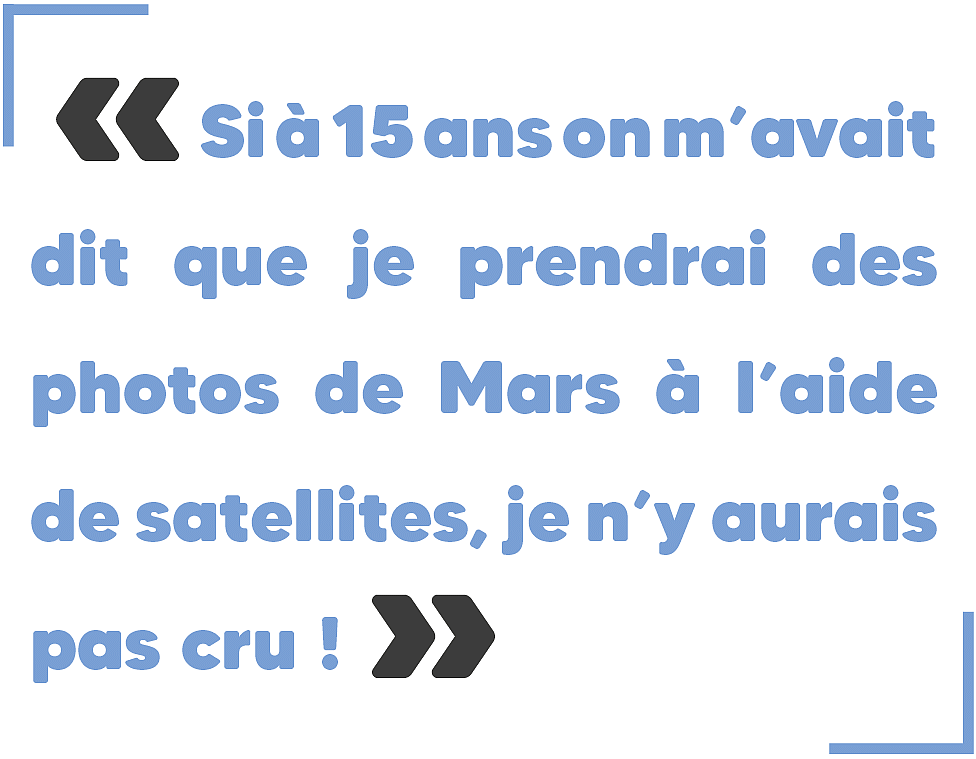
Observation et exploration : plusieurs regards
La géomorphologie, c’est l’étude des reliefs et paysages, et des processus qui les façonnent. Elle repose ainsi sur l’observation.
Avec l’expérience, l’œil s’habitue à identifier et reconnaitre les
différentes formes et structures du paysage liées à des processus
géologiques. Pour compléter ces observations, il est possible de
multiplier les approches, en comparant notamment avec les résultats
d’expériences de laboratoire, qui reproduisent les conditions de
pression et température que l’on retrouve à la surface de Mars. En plus
de cela, il est possible d’apporter un autre regard sur la surface de
Mars en utilisant des modèles numériques qui tentent de
reproduire des processus physiques. Ces simulations peuvent alors être
comparées avec les observations, et ainsi aider à la compréhension des
processus géomorphologiques qui façonnent la surface de la planète.
Une étude riche et prometteuse ! En attendant, le mot de la fin revient à l’aspect passionnant du métier de planétologue : Noé parle alors de l’importance de la communication sur ses travaux et sur l’étude de Mars en général. Durant des évènements tels que la fête de la science, il a pu voir la fascination dans les yeux des enfants à qui il racontait l’histoire de l’eau et de la glace sur Mars. Un parcours passionnant : « si à 15 ans, on m’avait dit que je serais associé à une équipe de recherche internationale et que je prendrais des photos de Mars à l’aide de caméras embarquées sur des satellites, je n’y aurais pas cru ! ».




